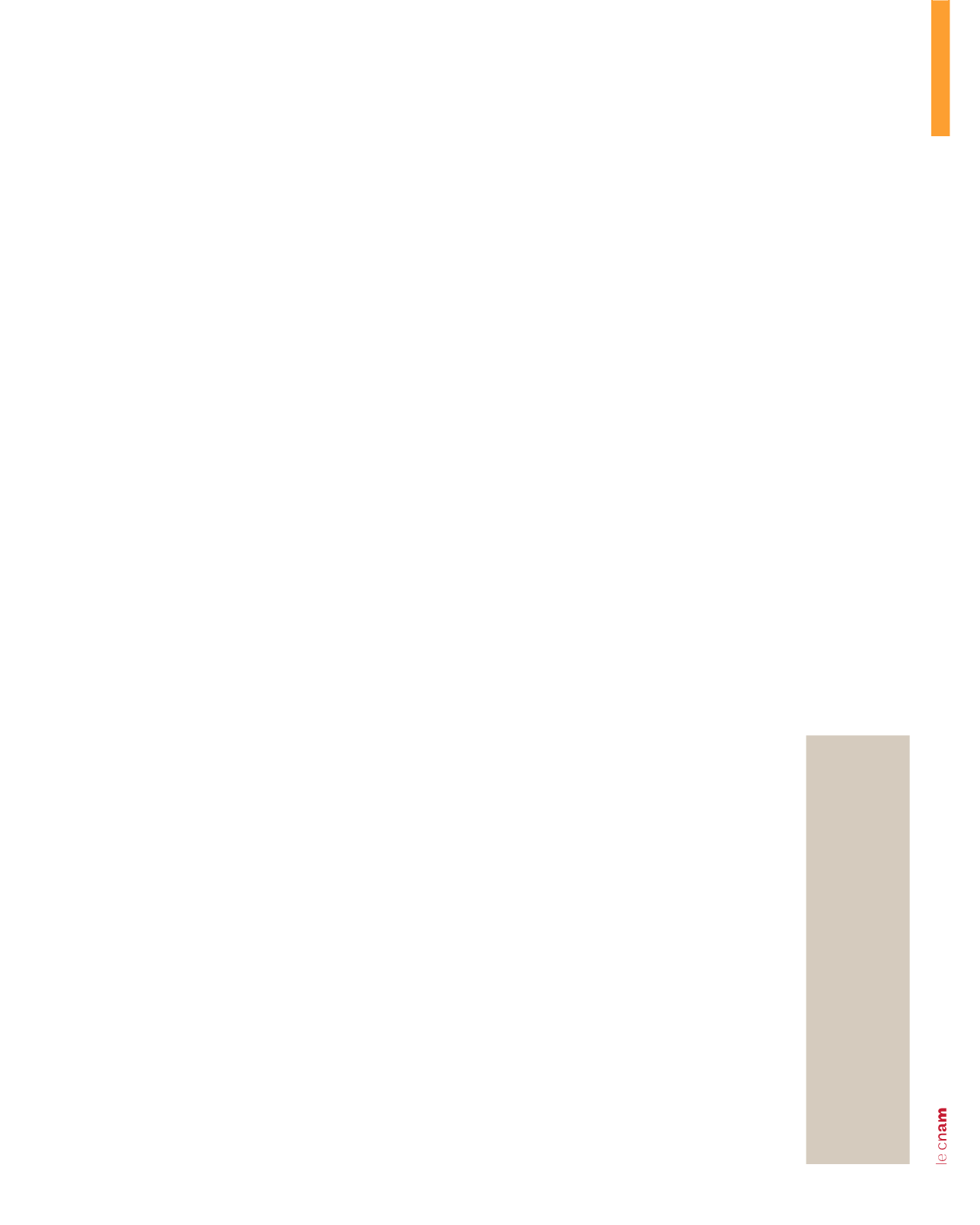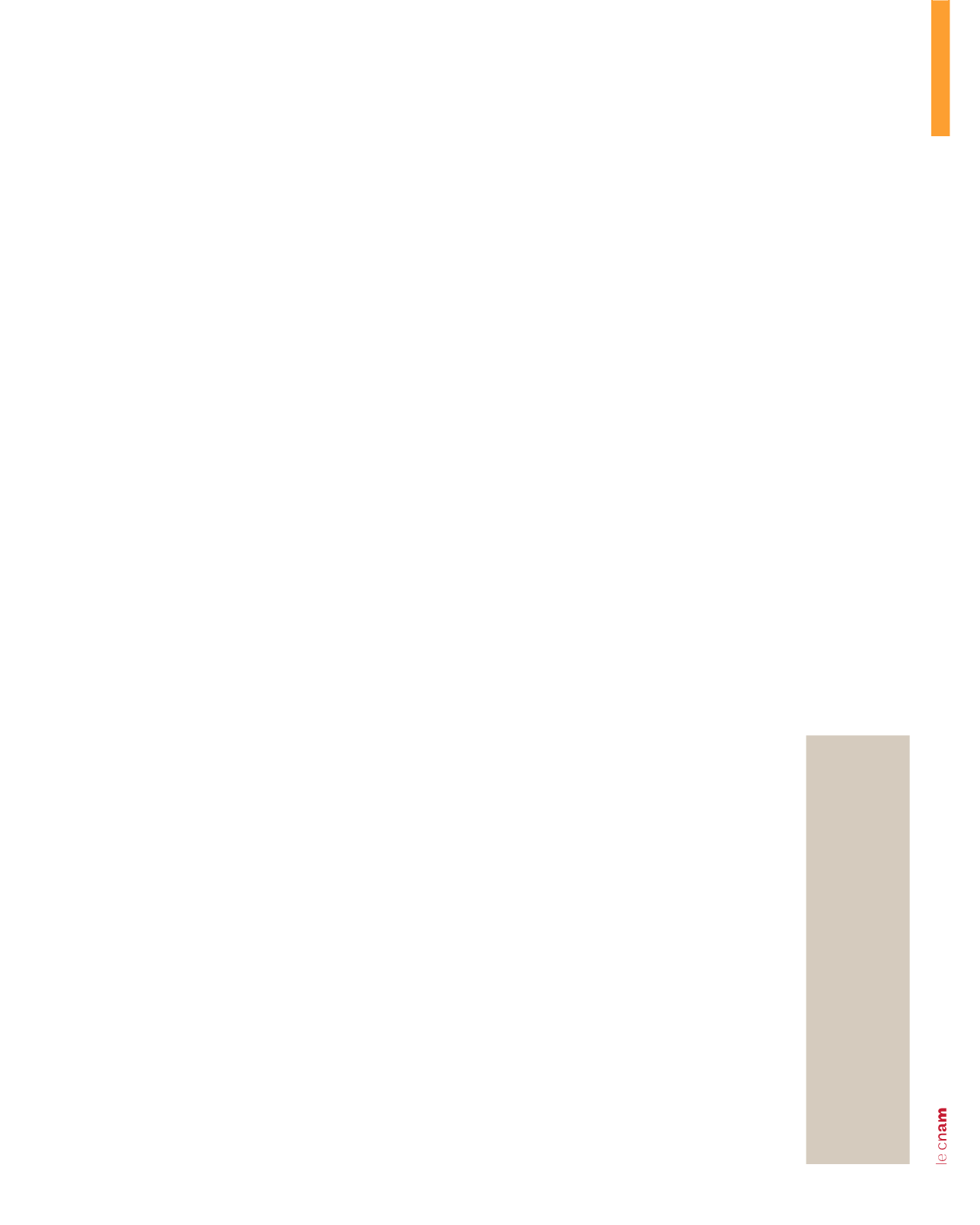
mag'
35
de la garde nationale en tête, la colonne défile sous la
porte Saint-Martin pour rejoindre l’Assemblée. Mais, le
cortège tombe soudain sur «
un fort détachement mili-
taire
[qui]
débouche, au trot, par la rue de la Paix, se jette
sur cette longue foule massée, la coupe en tous les sens,
la pousse du pied de ses chevaux et de la pointe de ses
baïonnettes
»
5
. Les rumeurs de cette répression
atteignent rapidement la rue du Hasard, lieu habituel
des réunions de la Montagne. Ceux qui s’y trouve
décident de «
gagner le Conservatoire où l’on disait la 5
e
et la 6
e
légions réunies sans armes
[pour]
se mettre à
leur tête et marcher en faisant entendre les cris de "Vive
la Constitution ! Vive la République romaine !"
»
6
.
Ainsi, vers deux heures et demie, le concierge du
Conservatoire vient prévenir son directeur, Claude
Servais Pouillet, de l’arrivée d’une colonne, composée
d’une trentaine de représentants du peuple en écharpes
et grandes tenues, de membres du comité démocratique
socialiste, du comité de la presse ou de la société des
droits de l’homme, ainsi que d’artilleurs en armes et
panaches rouges. À sa tête, Alexandre Ledru-Rollin sol-
licite une pièce pour tenir conseil. Malgré un premier
refus d’ouvrir les portes de «
l’asile de la science et de la
paix
»
7
, le directeur de l’établissement doit céder face à la
menace et les conduit dans l’ancien amphithéâtre.
La défense du siège de l’insurrection s’organise alors
rapidement. À l’intérieurs des cours,
«
on voit partout un mélange confus
d’artilleurs en tenues et de gens sans
uniformes : ceux-là portant la cara-
bine, ceux-ci, le fusil de guerre ou le
fusil de chasse
»
7
. Les artilleurs
élèvent des barricades au coin du
réfectoire, derrière la porte ouvrant sur le 220 et dans la
brèche d’un mur délabré. D’autres fleurissent dans les
rues alentours : une charrette de fumier, un tombereau
et des roues de voitures bloquent la rue Saint-Martin à
une quarantaine de pas du Conservatoire ; des planches
et des pièces de bois forment un obstacle sommaire rue
du Pont-aux-Biches ; des pavés s’entassent rue Chapon...
Les maisons environnantes, rue du Vertbois, rue
Frépillon, rue des Vertus... sont fouillées à la recherche
d’armes et de munitions tandis que les armureries sont
prises d’assaut.
Claude Servais Pouillet tente de son côté de sauvegarder
ses collections en conjurant les insurgés de ne pas faire
du «
Conservatoire un champ de bataille, un champ de
massacres
» et en les invitant à se retirer «
au nom de
l’humanité, au nom de la science, au nom du peuple,
auquel les Arts et métiers sont consacrés
»
7
. De leur
côté, les leaders de la Montagne envoient des émissaires
pour se «
renseigner sur ce qui se passe et hâter, si pos-
sible, l’arrivée des gardes nationaux
»
6
. Et, en attendant
«
que les débris de la manifestation se soit ralliés et que
la sixième légion
[les ait]
rejoint
»
8
, ils diffusent un nouvel
appel au peuple : «
La Constitution est violée ! Le peuple
se lève pour la défendre. La Montagne est à son poste.
Aux armes ! Aux armes ! Vive la République ! Vive la
Constitution !
»
10
.
Soudain, des coups de feu retentissent. Une compagnie
de soldats, arrivée par le passage du Cheval-Rouge,
attaque la barricade de la rue Saint-Martin. Le bruit des
combats attire quatre compagnies du 62
e
de ligne qui
franchissent rapidement ce premier obstacle puis
enlèvent le poste assurant la défense des grilles du
Conservatoire. Au sein de l’établissement, la déroute est
complète. Pour éviter le bain de sang autant que pour
sauvegarder l’établissement dont il a la responsabilité, le
directeur demande alors à son «
domestique d’aller
ouvrir la grille à l’extrémité de la rue Vaucanson, près de
la rue du Vertbois
»
7
. Une autre grille, donnant sur la rue
de Breteuil et le marché Saint-Martin, est ouverte par le
concierge sous la menace des artilleurs. Par les vasistas
et les fenêtres, les cours et les jardins, les assiégés s’en-
fuient. Si bien que lorsque qu’à quatre heures le 24
e
de
ligne prend possession du Conservatoire, il est entière-
ment déserté.
«
Il est temps que les méchants tremblent
»
Le rideau se baisse donc sur un triple échec. Échec
d’abord pour les Montagnards puisque la manifestation
est rapidement dispersée et que sont recensés des
dizaines de morts et plus de 1 500 prisonniers. Les plus
influents seront traduits devant la Haute cour de justice
pour complot et attentat contre la République quatre
mois plus tard. L’acte d’accusation égrainera alors pas
moins de soixante-sept noms parmi lesquels trente-et-
un représentants du peuple, décapitant ainsi l’opposition
républicaine.
Échec ensuite pour Claude Servais
Pouillet qui, malgré sa «
conscience
de n’avoir manqué ni de dignité, ni de
résolution, ni de courage
[et]
d’avoir
loyalement rempli tous
[ses]
devoirs
d’administrateur, de bon citoyen, d’ami dévoué de
l’ordre
»
7
, est accusé de laxisme envers les insurgés
avant d’être révoqué de ses fonctions de directeur du
Conservatoire.
Échec enfin, et surtout, pour les libertés naissantes,
accordées quelques mois plus tôt. Ce dernier soubre-
saut révolutionnaire marque en effet un réel tournant
répressif, qu’annonce Louis-Napoléon Bonaparte le jour
même dans une proclamation au peuple français en
assurant qu’il «
est temps que les bons se rassurent et
que les méchants tremblent
». L’Assemblée adopte ainsi
en urgence l’état de siège pour la ville de Paris et toute la
circonscription de la première division militaire afin que
la République ne périsse dans l’anarchie sous les coups
d’une «
minorité factieuse
[qui]
voulait opprimer la
majorité issue du suffrage universel
». Puis, une «
série
de lois draconiennes qui sont l’impôt obligé des journées
fatales au peuple, la prime ordinaire des contre-révolu-
tions heureuses
»
5
viendra limiter les libertés de la
presse et de réunion. Le chemin vers le coup d’État de
décembre 1851 est désormais ouvert.
YB
5: Alexandre
Ledru-Rollin,
Le
13 juin
, Bruxelles,
1849.
6: Victor
Considérant,
Affaire du
Conservatoire
,
Bruxelles, 1849.
7: Claude Servais
Pouillet,
Le
Conservatoire des
arts et métiers
pendant la journée
du 13 juin 1849
,
Paris, 1849.
8: Lettre d’Auboin
adressée au
général Dumas en
août 1849.
10: Acte
d’accusation de
la Haute cour de
justice.
360 degrés
Lorsqu’à quatre heures le 24
e
de ligne prend possession du
Conservatoire, il est entière-
ment déserté